Détection par les oiseaux de la rotation de pales noires et blanches
Etude/Recherche
Mis en ligne le : 29/09/2025
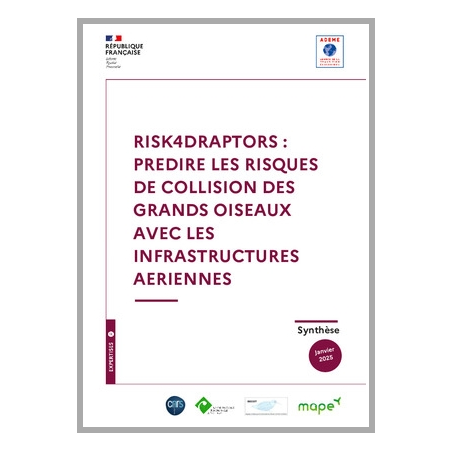
La perte de la biodiversité est une crise majeure de l’anthropocène à laquelle l’humanité est actuellement confrontée. Le changement climatique est une des causes principales de cette crise, qui affecte aussi les sociétés humaines. Pour faire face au changement climatique, une des stratégies adoptées vise à décarboner la production d’énergie et à opter pour son électrification à l’aide d’énergies renouvelables. Ces orientations induisent la construction d’infrastructures aériennes comme les éoliennes et l’extension des réseaux de transport d’électricité, ce qui n’est pas sans conséquence pour la faune et la flore (pertes d’habitats, mortalités par collisions), et peut ainsi aggraver la perte de biodiversité. Les grands oiseaux planeurs, comme les accipitridés, sont des espèces très sensibles au développement de ces infrastructures. Leur écologie et leurs modes de vol les placent en effet en conflit d’utilisation de l’espace aérien avec ces infrastructures. Leur dynamique de populations est aussi très sensible aux mortalités additionnelles. Plusieurs de ces espèces sont présentes sur la liste rouge de l’IUCN et protégées à l’échelle française et européenne. Ces espèces « à enjeux » sont donc à prendre en compte dans la planification et les études d’impacts précédant l’implantation des infrastructures aériennes. Il est cependant difficile de définir sur le terrain les zones d’importance pour ces espèces et donc de préconiser des secteurs où il faudrait éviter d’implanter ces infrastructures. Les avancées technologiques récentes, avec la miniaturisation des balises de télémétrie GPS, permettent de suivre des individus d’espèces aviaires en continu, en enregistrant leur localisation et leur hauteur de vol. L’objectif de ce projet était de développer un cadre méthodologique pour prédire les zones à risque de collision pour les grands oiseaux planeurs avec les infrastructures aériennes se basant sur leur utilisation des habitats naturels et leurs hauteurs de vol. Cette démarche a été développée sur l’aigle royal, mais réfléchie pour être réplicable à d’autres espèces d’oiseaux.
Dans un premier temps, les conditions nécessaires à l’utilisation des données télémétriques obtenues en équipant des jeunes aigles royaux au nid ont été étudiées afin d’augmenter le nombre d’individus mais aussi l’étendue géographique des données disponibles (et les habitats naturels associés) pour les modèles statistiques. Ces jeunes sont peu mobiles lorsqu’ils sont au nid et donc plus faciles à capturer que les adultes. Cependant, après l’envol, ils passent par une période d’apprentissages pendant laquelle leurs techniques de vol et leur utilisation de l’espace et des habitats naturels peuvent différer de celles des adultes. Les résultats obtenus montrent que, passé les deux premiers mois, les performances de vol sont ensuite établies et l’utilisation de l’espace et des habitats naturels par les jeunes deviennent alors très similaires à celles des adultes. Les données télémétriques des jeunes aigles royaux peuvent donc être utilisées, au même titre que celles des adultes, si l’on exclut les deux premiers mois après l’envol.
Dans un second temps, le risque qu’un aigle royal utilise un secteur pour ses déplacements a été modélisé, en fonction des habitats naturels qui composent ce secteur et en tenant compte de la hauteur à laquelle l’aigle vole. Pour cela, la méthode des « step-selection functions », classiquement utilisée pour modéliser la sélection d’habitats lors de déplacement en deux dimensions, a été adaptée à une sélection d’habitats en trois dimensions. En effet, ne pas tenir compte de la hauteur de vol peut conduire à surestimer le risque dans certains secteurs où, en réalité, les oiseaux volent très haut et ne sont donc pas en conflit d’utilisation de l’espace aérien avec les infrastructures. Ce modèle inclue aussi la troisième dimension dans les variables d’habitats via des paramètres décrivant l’espace aérien, à savoir les courants ascendants thermique et orographique, qui ont été reconstitué à l’échelle nationale dans le cadre de ce projet. Les résultats sont consultables sous forme de cartes qui permettent de visualiser les secteurs les plus à risque de l’espèce d’intérêt. Elles ont été pensées comme un outil d’aide à l’évitement à destination des aménageurs et des décisionnaires.
La perte de la biodiversité est une crise majeure de l’anthropocène à laquelle l’humanité est actuellement confrontée. Le changement climatique est une des causes principales de cette crise, qui affecte aussi les sociétés humaines. Pour faire face au changement climatique, une des stratégies adoptées vise à décarboner la production d’énergie et à opter pour son électrification à l’aide d’énergies renouvelables. Ces orientations induisent la construction d’infrastructures aériennes comme les éoliennes et l’extension des réseaux de transport d’électricité, ce qui n’est pas sans conséquence pour la faune et la flore (pertes d’habitats, mortalités par collisions), et peut ainsi aggraver la perte de biodiversité. Les grands oiseaux planeurs, comme les accipitridés, sont des espèces très sensibles au développement de ces infrastructures. Leur écologie et leurs modes de vol les placent en effet en conflit d’utilisation de l’espace aérien avec ces infrastructures. Leur dynamique de populations est aussi très sensible aux mortalités additionnelles. Plusieurs de ces espèces sont présentes sur la liste rouge de l’IUCN et protégées à l’échelle française et européenne. Ces espèces « à enjeux » sont donc à prendre en compte dans la planification et les études d’impacts précédant l’implantation des infrastructures aériennes. Il est cependant difficile de définir sur le terrain les zones d’importance pour ces espèces et donc de préconiser des secteurs où il faudrait éviter d’implanter ces infrastructures. Les avancées technologiques récentes, avec la miniaturisation des balises de télémétrie GPS, permettent de suivre des individus d’espèces aviaires en continu, en enregistrant leur localisation et leur hauteur de vol. L’objectif de ce projet était de développer un cadre méthodologique pour prédire les zones à risque de collision pour les grands oiseaux planeurs avec les infrastructures aériennes se basant sur leur utilisation des habitats naturels et leurs hauteurs de vol. Cette démarche a été développée sur l’aigle royal, mais réfléchie pour être réplicable à d’autres espèces d’oiseaux.
Dans un premier temps, les conditions nécessaires à l’utilisation des données télémétriques obtenues en équipant des jeunes aigles royaux au nid ont été étudiées afin d’augmenter le nombre d’individus mais aussi l’étendue géographique des données disponibles (et les habitats naturels associés) pour les modèles statistiques. Ces jeunes sont peu mobiles lorsqu’ils sont au nid et donc plus faciles à capturer que les adultes. Cependant, après l’envol, ils passent par une période d’apprentissages pendant laquelle leurs techniques de vol et leur utilisation de l’espace et des habitats naturels peuvent différer de celles des adultes. Les résultats obtenus montrent que, passé les deux premiers mois, les performances de vol sont ensuite établies et l’utilisation de l’espace et des habitats naturels par les jeunes deviennent alors très similaires à celles des adultes. Les données télémétriques des jeunes aigles royaux peuvent donc être utilisées, au même titre que celles des adultes, si l’on exclut les deux premiers mois après l’envol.
Dans un second temps, le risque qu’un aigle royal utilise un secteur pour ses déplacements a été modélisé, en fonction des habitats naturels qui composent ce secteur et en tenant compte de la hauteur à laquelle l’aigle vole. Pour cela, la méthode des « step-selection functions », classiquement utilisée pour modéliser la sélection d’habitats lors de déplacement en deux dimensions, a été adaptée à une sélection d’habitats en trois dimensions. En effet, ne pas tenir compte de la hauteur de vol peut conduire à surestimer le risque dans certains secteurs où, en réalité, les oiseaux volent très haut et ne sont donc pas en conflit d’utilisation de l’espace aérien avec les infrastructures. Ce modèle inclue aussi la troisième dimension dans les variables d’habitats via des paramètres décrivant l’espace aérien, à savoir les courants ascendants thermique et orographique, qui ont été reconstitué à l’échelle nationale dans le cadre de ce projet. Les résultats sont consultables sous forme de cartes qui permettent de visualiser les secteurs les plus à risque de l’espèce d’intérêt. Elles ont été pensées comme un outil d’aide à l’évitement à destination des aménageurs et des décisionnaires.
Documents associés
Etude/Recherche
Mis en ligne le : 29/09/2025
Risk4DRaptors : Prédire les risques de collision des grands oiseaux avec les infrastructures aériennes